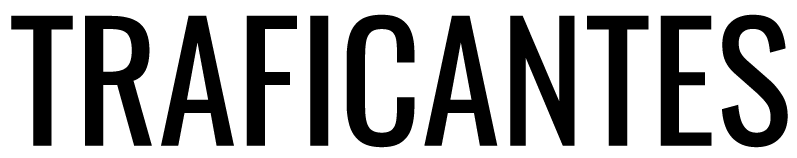Ce que l'on appelle couramment la Guerre d'Algérie était une radicalisation de la terreur d'Etat contre un peuple qui se pensait en tant que tel et qui prit les armes pour s'émanciper. Comprendre ces événements signifie en saisir les enjeux, non pas seulement en termes militaires, géopolitiques ou simplement humains mais encore d'un point de vue politique, voire philosophique. Les Algériens ne se sont pas battus contre les Français, mais contre l'appropriation de leurs terres et pour se libérer d'un système d'oppression et d'exploitation: le colonialisme. Dans ce processus d'émancipation, des Français ont choisi le camp de la liberté et de l'égalité: celui du peuple algérien en lutte. Leurs motivations politiques furent variées. On retrouvait des communistes en rupture de ban, des trotskystes, des anarchistes, des chrétiens, des anticolonialistes ou des humanistes. Les solidarités et les résistances étaient multiples: du soutien logistique au FLN à la dénonciation de la torture en passant par la désertion ou la diffusion de propagande anticolonialiste. Les engagements allaient d'un refus d'obéir à des ordres jusqu'à un investissement total aux côtés du peuple algérien, qui continuera d'ailleurs après l'indépendance. Parfois écrits à la première personne, ces textes nous invitent à lire autrement l'histoire de la Guerre d'Algérie. Ils exposent les prises de conscience, les espoirs et les actions d'hommes et de femmes qui ont choisi de se battre contre l'injustice, pour la dignité et pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
AUTOR/A
BARKAT, SIDI-MOHAMMED
Sidi Mohamed Barkat (né en 1948 à Oran) est un philosophe algérien installé à Paris.<BR><BR>Ancien directeur de programme au Collège international de philosophie de 1998 à 2004, il est chercheur associé au Laboratoire de psychologie du travail et de l'action du Conservatoire national des arts et métiers. Après des années d?enseignement à l?université, où il s?est occupé essentiellement de questions d?épistémologie des sciences sociales, Sidi Mohammed Barkat a dirigé de 1998 à 2004 un programme de recherche au Collège international de philosophie, à Paris, sur l?image et la condition de « l?indigène algérien ».<BR><BR>Auteur d'un concept à caractère juridique, politique et social sous la terminologie de corps d'exception. Il fait directement référence aux populations algériennes sous occupation française. Pierre Tevanian est un des rares chercheurs à l'avoir utilisé dans un article1[réf. incomplète], puis un chercheur en philosophie, Lionel Rebout dans une thèse de doctorat soutenue en 2009 : "Processus de visibilisation et mode d'apparaître en milieu carcéral", sous la direction de Stéphane Haber.<BR><BR>D'autres chercheurs encore mentionnent ou ont tenté d'utiliser ce concept dans leurs diverses recherches : Gérard Bras, Daniel Borrillo, Patricia Mothes, Malika Mansouri, Olivier Le Cour Grandmaison, Claire Hancock, Vincent Houillon.<BR><BR>Ce concept croise le débat des Indigènes de la République (voir Indigénat), discussion très politique.<BR><BR>Wikipedia